Texte rédigé dans le cadre d’un concours de La Quinzaine. La première phrase ainsi que la longueur du texte étaient imposées
Le vieux phare veillait encore, malgré les années. La lune se reflétait sur la pierre blanche, rendant presque accessoire le feu projeté du haut de la tour. J’avais quitté Loctudy en milieu d’après-midi, à l’heure de la sieste, la sacrosainte sieste ; j’étais certaine que personne ne me verrait partir. J’avais attendu d’être au large pour pousser le moteur et les muscles de mes bras étaient encore tout endoloris des premiers milles franchis à la rame. Mais j’y étais presque, enfin. L’air était étonnement doux pour une nuit d’avril, j’avais presque trop chaud sous mon ciré, je sentais la sueur couler entre mes omoplates. Ou peut-être était-ce à cause de la peur… Et s’il ne dormait pas ? S’il m’avait vue tirer le canot sur la plage ? Il ne fallait pas que j’y pense, il ne fallait plus que je pense à lui. Je devais rester concentrée à présent, éviter les récifs, me laisser dériver jusqu’à la pointe sud pour pouvoir accoster. La mer ne resterait pas calme longtemps, la tempête Nuria était annoncée pour les premières heures de l’aube, il fallait que je me mette à l’abri.
La porte était plus difficile à forcer que je ne m’y attendais. J’avais beau redoubler de coups, la clenche ne flanchait pas. Mes doigts s’écorchaient aux arêtes du morceau de granit avec lequel je frappais comme une damnée. Je commençais à entendre le sifflement du vent qui progressait au large, comme l’écho d’un hurlement de loup. Le claquement a retenti comme un coup de feu et je me suis figée, le souffle coupé. Puis il a recommencé, régulier, de plus en plus brutal au fur et mesure que les bourrasques commençaient à frôler la tour. Le bruit venait de l’arrière du bâtiment. Je l’ai contourné en me pliant en deux, presque à quatre pattes, doucement… et je l’ai vu. Un volet mal accroché. Il battait violemment et découvrait la moitié d’une lucarne en hauteur, à environ deux mètres du sol. Je ne pouvais pas renoncer, je n’avais pas le choix. Le grain n’allait pas tarder à atteindre l’île, et seul le bâtiment pouvait me protéger. J’y ai mis mes dernières forces, j’ai reculé de quelques pas pour prendre mon élan et j’ai sauté contre la façade, les bras en l’air, pour m’accrocher au rebord de la fenêtre. J’ai hurlé en poussant sur mes bras jusqu’à réussir à me coller à la vitre que j’ai brisée d’un coup de coude. Le verre a transpercé les couches de toile et de laine, perforé mon biceps et je hurlais encore en basculant de l’autre côté. Un cri rauque, animal, qui résonnait dans mon corps tout entier. Il se mêlait au fracas des vagues qui commençaient à frapper les rochers au pied du phare. Papy n’avait pas menti. A chaque coup de la houle sur la pierre, on aurait dit que l’île tout entière se mettait à trembler.
J’avais six ans lorsqu’il m’avait parlé de l’île pour la première fois. C’était juste après la mort de Mamie, il était venu passer quelques semaines à la maison. Ma mère avait pensé que passer du temps avec moi lui ferait oublier son chagrin, aussi c’est lui qui me récupérait à la sortie de l’école et m’emmenait prendre mon goûter au parc. Un soir, une averse avait éclaté subitement ; le ciel à peine voilé s’était brusquement empli de gros nuages noirs qui avaient éclaté, éclaboussant les bancs et transformant le sable où je jouais tranquillement en une mélasse glacée. Il m’avait prise dans ses bras et s’était engouffré sous la petite tourelle en bois d’où glissait le toboggan que je m’amusais à grimper à l’envers. Je frissonnais, mélange de froid et de peur, à chaque coup de tonnerre ; plus les minutes passaient, plus j’avais de mal à retenir mes larmes. Alors il s’était mis à me raconter… Sa vie à mon âge, sur une toute petite île, sans autres enfants pour lui tenir compagnie ; rien qu’une maisonnette que ses parents partageaient avec un ingénieur qui ne restait jamais plus que quelques mois. Son père, mon arrière-grand-père, était gardien du phare de l’Île aux Moutons. Le nom m’avait fait rire, j’imaginais une petite terre faite d’herbe grasse et recouverte d’agneaux au pelage mousseux. Mais en réalité les seuls animaux sur cette île étaient cinq poules et une vache qui fournissait le lait du petit déjeuner. Là-bas la foudre fracassait l’écume, la pluie giflait bruyamment les fenêtres de leur maisonnette. Mais à chaque tempête ils s’étaient inventé un rituel pour la défier : ils préparaient un chocolat et grimpaient tous, en chaussons, tout en haut du phare. De là, ils dominaient la mer, et observaient les éléments déchaînés comme un film dont ils auraient été les seuls spectateurs, privilégiés. Serrés tous les deux dans notre minuscule cabane, papy m’avait alors poussée à regarder le flash que faisaient les éclairs qui se reflétaient dans le métal du toboggan. Et à mon oreille il avait chuchoté : aucun orage ne doit t’effrayer, ce qui compte c’est que tu trouves le bon refuge.
J’ai senti la douceur du parquet sur la paume de ma joue. Je me suis relevée doucement et j’ai soulevé mon pull pour observer mon bras. Il saignait à peine, la plaie n’était pas très profonde, elle se confondait avec les traces laissées par les hématomes plus anciens. J’ai glissé mes mains sur les murs jusqu’à trouver l’interrupteur. J’ai laissé mon regard traîner sur le lit sans draps, le petit secrétaire usé, la chaise à l’assise en paille. Derrière la porte un palier donnait sur deux autres chambres et sur l’escalier en colimaçon. Je savais parfaitement me repérer, tout était conforme aux récits de papy. En bas il y avait la grande cuisine qui servait de salon et de bureau ; plus bas encore la cave, dont je savais qu’elle contenait des réserves de nourriture pour les étudiants qui venaient chaque mois effectuer des relevés depuis que l’île abritait une réserve ornithologique. J’ai choisi de grimper les 150 marches vers la cime du phare. Chacune d’entre elles réveillait une douleur : le tibia blessé lorsque j’avais heurté la table basse ; Les reins bleuis par les coups de pieds alors que je tentais de ramper vers le téléphone ; Le pouce gonflé par la torsion lorsque ce même téléphone m’avait été arraché de la main ; le sifflement persistant de mon tympan gauche depuis la première gifle, trois semaines plus tôt… jusqu’à ces marques rouges qui enserraient mon cou. L’empreinte des mains du monstre que je fuyais.
J’ai atteint la lanterne et je suis sortie sur le petit balcon, en m’agrippant à la rambarde. La tempête devait durer cinq jours. Personne n’accosterait d’ici là. Quand le calme reviendrait. Il faudrait sans doute faire fonctionner la radio pour appeler la police, être reconduite à terre, raconter, porter plainte, changer de ville, de vie. On verrait bien. En attendant j’étais là, seule, libre, dominant la tempête, tout en haut du vieux phare. Le meilleur des refuges.







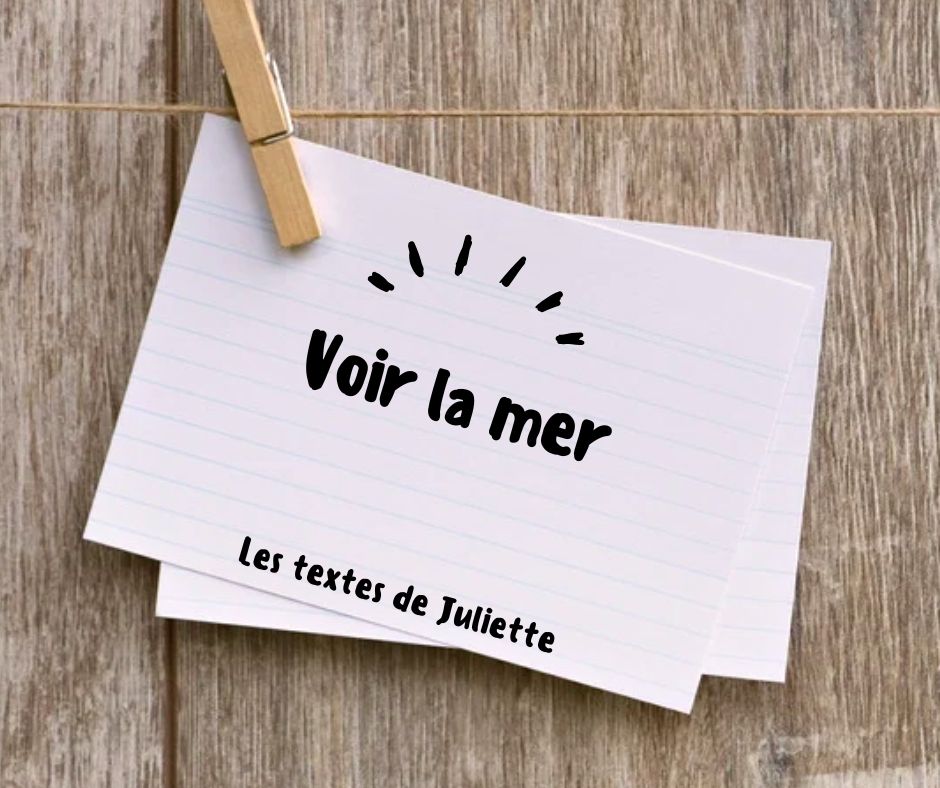

Laisser un commentaire