J’essaye de reconnaître quelque chose, trouver des repères familiers, mais les formes sont vagues. Tout est de cette étrange couleur mélange de beige et de rouille et semble flotter dans une poussière épaisse. J’attrape la télécommande et appuie sur pause, coupant la chique au commentateur, et je m’approche au plus près du téléviseur. J’ai beau passer mes doigts sur les quelques contours qui se détachent de l’enchevêtrement de pierres, ici un rectangle, là un carré, mon cerveau est incapable de les relier à quoi que ce soit de tangible. Le bandeau rouge qui barre le bas de l’écran affiche “Durbar Square, Katmandou”, mais c’est comme si tout en moi refusait d’y croire.
C’était il y a si longtemps, sept ans déjà. Depuis, les images se sont peu à peu estompées et d’autres souvenirs sont venus les remplacer. Durbar Square. J’avais presque oublié ce nom. Et le voilà qui resurgit un jour d’avril, prononcé sur toutes les antennes avec la solennité qui convient lors des drames. Un séisme d’une force inouïe a frappé le Népal, et ce tout petit rectangle de terre coincé entre l’Inde et la Chine est dévasté.
Le cagibi de l’entrée pourrait lui aussi avoir subi les répliques du séisme. Tout est sens dessus dessous là-dedans, il va bien falloir qu’un jour je me décide à le ranger. Je sors l’aspirateur, les seaux, une montagne de vieux sacs en plastique inutiles mais que je préfère savoir là que dans l’estomac des tortues, et j’accède enfin aux étagères. Là encore c’est un bazar honteux, des boîtes en bois, en carton, en fer qui s’entassent et menacent de m’ensevelir. Il faudrait que j’apprenne à jeter un jour.
Enfin je le trouve, poussé contre le mur. Un grand carton bleu sur lequel j’ai écrit “voyages” au marqueur, un jour où par miracle j’avais décidé de faire un peu de tri. A l’intérieur, plusieurs pochettes en plastique gonflées de papiers ; des dépliants, des vieux tickets, des cartes postales… Je les ouvre au hasard jusqu’à trouver la bonne, dont je répands le contenu sur le sol du salon. Un bâton d’encens roule sur le parquet. Je le respire. Et avec son odeur tout un cortège d’images, de sons, de sensations, ressurgissent d’un coup.
*****
Le pilote a eu beau indiquer que la température locale était de 33 degrés, l’air nous semblait frais sur le tarmac, et le blanc du ciel éblouissant. Rien à voir avec la touffeur et cette lumière jaune, presque ocre, dans laquelle nous baignions quelques heures plus tôt, lorsque nous étions montés à bord de l’avion à l’aéroport Indira Gandhi de Dehli.
Nous n’avions pas prévu cette escapade au Népal. Initialement, ce voyage en Inde était pour moi une forme de pèlerinage. L’envie d’aller voir là où tout avait commencé. J’étais née dans une ville banale de banlieue parisienne, mais mes premiers mois in utero m’avaient fait parcourir des milliers de kilomètres à travers la planète, parce que mes parents tenaient à ce que je naisse en France. Ils avaient laissé derrière eux la maison de Defence Colony, pour ma mère son travail à l’école française de New-Dehli, pour mon père ses collègues du bureau d’études de la compagnie d’ingénierie indienne qui l’employait, le personnel de maison auquel ils ne s’étaient jamais vraiment habitués, et ces drôles d’amitiés qui se nouent entre expatriés. Deux ans de leur vie. Ils avaient dû se résoudre à laisser tant de choses, mais c’est l’Inde tout entière qu’ils avaient emporté avec eux ; ses images, ses musiques, des souvenirs impérissables. Et j’avais grandi avec ce bout d’Orient partout autour, dans les objets et les bibelots parsemés dans la maison, dans les vêtements empilés dans une malle que nous remontions une fois par an de la cave et fouillions avec ma soeur comme on cherche un trésor, dans les films super 8 qu’on projetait régulièrement dans le salon.
Lorsqu’un soir, dans un bar, après quelques verres avec mon ami Christophe, nous nous étions lancé le défi de nous offrir un voyage lointain, c’est évidemment l’Inde que j’avais suggérée. Il fallait que je plante mes yeux dans ce pays qui m’attirait comme un aimant, que je la vive à mon tour, comme mes parents avant moi. Il avait accepté sans hésiter.
C’est dans ce même bar que je l’avais rencontré, deux ans plus tôt. Je venais tout juste de m’installer dans un nouvel appartement, et je m’offrais une pause-café entre deux coups de peinture. Il était assis à la table d’à côté, et couvrait un carnet de notes, concentré. Ça m’avait intrigué, j’aime les gens qui écrivent. Nous sommes instantanément devenus amis, fréquentant les mêmes bandes, partageant des soirées de fête, des cafés avant de partir au boulot, des barbecues dans les cours d’immeubles des copains. Plus tard, il m’a avoué qu’en réalité, dans ce petit carnet, il rédigeait une simple liste de choses à faire pour organiser sa journée. Je l’ai toujours soupçonné d’avoir plutôt consigné ses meilleures idées de jeux de mots. Christophe était alors le champion des calembours douteux, qui me faisaient rire à tous les coups, même si parfois c’était de désespoir. Il ferait sans nul doute un excellent compagnon de voyage.
A peine atterri, je l’avais laissé à l’hôtel pour sauter dans un rickshaw. Ma valise avait été provisoirement égarée lors de l’escale à Londres, mais j’avais tout ce qu’il me fallait dans mon sac à main : Quelques roupies, un petit appareil photo numérique, et une adresse sur un bristol que m’avait remis mon père avant notre départ. La traversée de la ville avait été laborieuse, les embouteillages tentaculaires nous engloutissaient tels de gigantesques monstres marins, et je voyais le soleil baisser dangereusement derrière la brume qui enserrait la ville. Mais nous avions réussi à parvenir à destination avant la nuit. J’avais tendu mon appareil au chauffeur et en quelques secondes la photo était prise. Trente-six ans après, mon image était immortalisée devant la maison où j’avais été conçue. De retour dans notre chambre, j’avais la sensation d’une mission accomplie. J’avais choisi la destination, je n’avais plus d’exigence sur le reste du voyage. Christophe était plongé dans un monceau de guides et de dépliants qu’il avait dû aller chercher à l’agence de voyage qui jouxtait l’hôtel. Rajasthan, Uttar Pradesh, ou même Goa, tout m’allait, il n’avait qu’à choisir. Il a brandi deux billets d’avion. “Katmandou. On part après-demain”. Quitter l’Inde. Provisoirement, certes, mais si vite après y être arrivés… Après tout, pourquoi pas. Le Népal aussi faisait partie des nombreux pays parcourus par mes parents ; et puis ce n’était pas que mon voyage, il fallait bien que j’accepte de me laisser glisser aussi dans celui rêvé par Christophe.
*****
Katmandou. Nous y étions. J’avais en tête des images où le temps se serait arrêté. Des enfants qui souriaient, des hippies qui fumaient, une impression de calme, la pureté des montagnes, la sérénité des temples. Le Katmandou suspendu des films super 8, avec comme seule bande son le frottement saccadé des bobines qui tournent sur le projecteur. Mais nous avions débarqué au beau milieu d’un chaos bruyant et coloré, baigné dans une odeur d’encens. Dans les ruelles de Thamel, où nous logions, les chaussées laissaient régulièrement place à des chemins de boue, des milliers de mètres de fils électriques s’enchevêtraient d’une baraque à l’autre, reliés à des groupes électrogènes de fortune, et tout ça dans la rumeur des klaxons qui s’élevaient d’un peu plus loin dans la ville. Nous les avions aperçues sur la route depuis l’aéroport, ces files interminables de motos devant les stations essence, plus loin nous avions dépassé des manifestants qui brandissait des têtes en papier mâché sur des piques. Le réceptionniste de l’hôtel nous avaient traduit les articles des journaux, qui évoquaient la révolution française et la Commune de Paris, qui inspiraient des manifestants qui criaient “mort au roi”. Après dix ans de guerre civile, la révolution maoïste s’était doucement éteinte, la monarchie était abolie, mais le Népal ne se relevait pas. La crise politique grondait, le parlement ne parvenait pas à élire un président, l’essence manquait. Sans le savoir, nous étions un recours. Voilà pourquoi les vols étaient si peu chers, les visas presque distribués sans formalités : nous prenions part au retour d’un tourisme qui avait disparu, et qui était la principale source de revenus locale.
Dès le soir de notre arrivée, nous avons compris que ce séjour ne serait pas comme les autres. Pour ce premier dîner népalais, nous avions choisi de nous rendre au Thamel Rest House, désigné incontournable par tous les guides que nous avions consultés. Un restaurant qui offrait un menu “typique” de pas moins de onze plats. Le lieu était magique, entièrement éclairé à la bougie. Le maître d’hôtel nous avait conduit au dernier étage, sous les combles, et fait asseoir autour d’une table basse, sur des coussins posés à même le sol. La lueur des flammes nous enveloppait d’une lumière orange envoutante. Une grande bouteille d’alcool de riz trônait, prête à être entamée. Mais nous étions affamés et fatigués, aussi nous avons préféré commencer par des boissons moins… risquées. Nous avons commandé un “lassi à la banane”, une boisson à base de yaourt brassé dont Christophe était tombé totalement accro lors de notre bref passage en Inde. Et là le visage du serveur, jusqu’ici affable et souriant, a pris un air contrit. Il a montré la salle autour et a rétorqué “no light, no banana”. Nous avons eu un peu honte, visiblement le lieu était un peu trop chic pour se compromettre à y demander des lassis, et nous sommes résolus à entamer la bouteille. Onze plats et beaucoup de verres plus tard, alors que nous nous demandions comment nous allions réussir à nous extirper de ces coussins, avec nos estomacs pesant trois tonnes nos têtes qui tournaient un peu, nous avons entendu un grand vrombissement et des ampoules se sont allumées partout autour de nous, provoquant un “ah” soulagé des clients et du personnel. C’est alors que nous avons compris : les bougies ne faisaient pas partie du décor. Elles étaient là pour nous éclairer en l’absence d’électricité. Et si nous n’avions pas eu de lassi à la banane, c’était tout simplement parce que les appareils servant à les mixer ne pouvaient pas fonctionner. Nous sommes rentrés à l’hôtel en riant sous des trombes d’eau chaude qui nous ont trempés jusqu’aux os. C’était notre première mousson.
Malgré la pluie qui nous faisait patauger dans la boue du matin au soir, malgré les manifestations qui dégénéraient parfois violemment, malgré les sommiers grinçants de l’hôtel qui nous réveillaient à chaque petit mouvement, j’aimais Katmandou. Je m’étais habituée au tapage permanent, plus strident, plus métallique que le vacarme indien qui nous avait cueillis à notre arrivée à Dehli, et j’étais prête à rester tous les quatorze jours que nous autorisaient nos visas. La chasse au Lassi Banana était devenu un running gag : un soir, dans un bar à chicha, on nous l’avait refusé d’un “10 o clock, no banana”, signifiant qu’à cette heure le groupe électrogène était déjà éteint, rationnement oblige. Quand l’averse se calmait nous allions nous prélasser sur les terrasses en hauteur des bars de la vieille ville, où l’on croisait parfois des occidentaux à dreadlocks qui tentaient de faire revivre un passé disparu. On testait les masseurs, les esthéticiennes, on achetait des tissus en soie et des vestes bariolées qui déteignaient sur notre peau. On essayait de repérer dans quelle école allait les enfants qu’on croisait en fonction de la couleur de leur uniforme. On visitait Durbar Square en payant des tarifs cent fois plus élevés que les visiteurs locaux, sans ciller ; ça restait des sommes dérisoires, une petite poignée d’euros, et le pays en avait bien besoin. Au bout de quelques jours, nous avons réussi à aller visiter Patan. Ça n’avait pas été facile, car la plupart des taxis étaient bloqués faute d’essence. Mais nous avions fini par trouver un particulier disposant d’assez de carburant pour aller au-delà de la rivière Bagmati et franchir les douze kilomètres aller-retour qui nous permettraient de découvrir celle qu’on désignait comme “la cité de la beauté”. Nous avons pris place à bord d’une voiture sans âge avec cet homme et sa fille, qui a chanté tout au long du chemin. A l’arrivée, nous sommes descendus devant un temple splendide. Et nous avons redécouvert le silence… à peine chahuté par quelques rires de singes.
C’est à Patan, dans un tout petit restaurant en bordure d’une place, que nous avons rencontré Hélène et Béatrice. Nous étions en train de nous régaler de momos cotays, ces raviolis tibétains moitié frits moitié vapeur, lorsque nous avons entendu deux femmes rire quelques tables plus loin. Bizarrement, mais c’est à ce rire que nous avons compris qu’elles étaient françaises. Francophones pour être exacte, car en réalité elles habitaient Genève. Elles étaient mère et fille, et irrésistiblement joyeuses. Nous logions dans le même hôtel, et pourtant nous ne nous étions encore jamais croisés. C’était la première fois qu’elles venaient au Népal, mais Hélène connaissait bien l’Inde. A à peine vingt-quatre ans, elle y avait déjà fait huit séjours, depuis son premier voyage avec un amoureux alors qu’elle terminait tout juste le lycée. Lors d’une visite de Benares, elle était tombé sur un homme, Ashish, qui avait créé une école destinée aux enfants des rues. Depuis, elle y retournait au moins une fois par an, durant plusieurs semaines, pour apporter des fournitures, aider les enseignants – eux-mêmes parfois anciens élèves, participer aux petits travaux d’entretien des bâtiments. Cette fois elle avait décidé de faire découvrir cette part essentielle de sa vie à sa mère, et en avait profité pour découvrir enfin le Népal avec elle. C’était la fin de leur séjour à Katmandou, elles reprenaient le lendemain la route pour Benarès – « ce serait bien qu’on s’y retrouve quand vous reviendrez en Inde ! Mais vous ne pouvez pas quitter le Népal sans avoir vu Pokhara ! ». Elles parlaient de Pokhara comme d’un paradis, elles n’avaient pas assez de superlatifs pour qualifier le lac et la pagode de la paix que l’on rejoignait en barque, les flancs de l’Annapurna, majestueux, qui dominait la ville… “on dirait la Suisse !”. Sur ces mots définitifs qui ont à nouveau fait retentir leurs rires, et les nôtres, nous nous sommes séparés en nous promettant de partager ensemble le lendemain matin leur dernier petit déjeuner au Ganesh Himal Hôtel. De retour à Katmandou, nous avons demandé à notre co-voitureur de nous déposer dans le quartier Sohrakkhutte, où j’avais repéré une enseigne qui indiquait “Baba Adventure – travels, tour, trek – Kathmandu – Pokhara”.
L’aéroport, encore. Je n’aurais jamais autant pris l’avion en si peu de jours. J’aurais préféré le bus, traverser le pays par la route pour découvrir ses paysages à hauteur d’homme. Mais la difficulté à trouver du carburant avait fait flamber les prix. De plus, le président enfin désigné n’était pas soutenu par les maoïstes, et des petits groupes de rebelles s’étaient recréés, s’attaquant parfois aux cars de touristes. Alors l’avion… Malgré les nuages qui écrasaient la ville, j’espérais qu’une éclaircie interviendrait pendant le vol pour nous permettre d’admirer les sommets de l’Himalaya. J’avais insisté pour qu’on parte tôt, qu’on soit en avance et qu’on ait une chance de monter les premiers dans l’avion pour pouvoir m’asseoir près d’un hublot. Nous suivions un agent de la compagnie à pied, nos bagages à la main. Il fallait slalomer entre les avions. Le nôtre se tenait tout au bout de ce qui ressemblait à un immense parking. Il était à l’écart, comme s’il était puni. Sa piteuse allure n’avait rien de rassurant. Un tout petit appareil à la carcasse usée avec sur le flanc un logo à demi effacé. Nous avons grimpé l’escalier en nous agrippant à la rampe, pris d’un fou rire nerveux. A l’intérieur, le problème du hublot s’est rapidement réglé : il n’y avait que douze sièges, six de chaque côté d’une minuscule allée. À chacun son hublot. Je me suis effondrée à l’avant, au premier rang, mon sac sur les genoux. A l’intérieur, bien rangé dans une pochette kraft, mon permis de treking, une autorisation d’accéder à l’ « Annapurna conservation area », et le numéro de Durdra, notre guide, qui devait nous retrouver à la descente de l’avion. Notre vieux zinc a tenu le choc, malgré les trous d’air qui faisaient trembler tout l’habitacle. Deux cents kilomètres à se frayer dans les nuages épais. A essayer de deviner l’ombre des montagnes.
*****
Durdra. L’homme le plus gentil au monde. Il nous attendait bien, comme prévu, à l’aéroport, et s’est installé avec nous dans la navette à qui nous menait vers la ville. Il nous expliquait tout ce qu’on voyait sur le trajet : le camp de réfugiés tibétains, la rivière Seti que la mousson faisait déborder, les quartiers de la ville qu’on ne voyait jamais sur aucune photo… son anglais était bien meilleur que le nôtre. Enfin nous sommes arrivés à Lake Side, notre point de chute. Une longue avenue longeait le lac, bordée de supermarchés, d’agences de voyages, de cyber cafés, de centres de massages et de restaurants aux spécialités du monde entier. Un quartier entièrement dévoué au tourisme du Trekk. La guest house où il nous amenait se trouvait à deux pas, dans une petite rue perpendiculaire. Une fois sur place, nous nous sommes assis dans le petit jardin derrière la maison. Il a aussitôt abandonné son sourire pour nous expliquer la situation : Ici aussi, il n’y avait plus d’essence. Et par conséquent de moins en moins de voiture en mesure de nous emmener au point de départ du trek. Il finirait par en trouver une, il en était certain. Mais ça risquait de prendre un peu plus de temps que prévu. Sans doute deux ou trois jours. Et il faudrait sans doute la partager. A ce moment précis un rayon de soleil a percé les nuages pour venir se cogner contre nos verres de thé. Un peu de vent a fait frémir les grands arbres mâts qui nous cachaient du regard des voisins. Il faisait bon. Le trek pouvait bien attendre.
A partir de là, ce fut chaque jour le même rituel. Nous nous retrouvions à 11h et à 17h dans le jardin du lodge et Durdra nous faisait le point sur ses recherches. Au fur et à mesure, nos discussions s’étoffaient ; nous avions étudié point par point le tracé qu’il nous proposait, entouré les différentes étapes sur la carte, pris note des lodges sur le parcours, vérifié que notre équipement était suffisant. Désormais, nous pouvions prendre le temps de parler de nous. Durdra aimait profondément le Népal, ça respirait dans chacune de ses phrases, quand il nous décrivait la montagne, les sentiers de son enfance. Son père avait été Sherpa, et longtemps les pentes de l’Annapurna avait été son terrain de jeu, un terrain de jeu qu’alors il rêvait immuable. Presque naturellement, il était devenu guide. Et les rencontres qu’il avait faites lui avaient ouvert les yeux et l’appétit d’un monde bien plus grand que le sien. Les dix dernières années avaient été terribles. Les touristes avaient déserté. Seuls les alpinistes chevronnés venaient encore se lancer à l’assaut des sommets. Durdra avait essayé de partir des dizaines de fois. Il avait pris la route jusqu’à Katmandou pour faire le siège des ambassades, obtenir un visa. Un client londonien avec qui il avait sympathisé lui avait même rédigé une invitation en bonne et due forme. Mais l’Europe n’était pas une terre accueillante pour tout le monde. Même pour un simple séjour, ses portes ne s’ouvraient pas si facilement. Alors Durdra s’était peu à peu fait une raison. Il resterait. Lorsqu’il nous parlait de ses rêves enterrés, je pensais à ce coup de tampon dans mon propre passeport, si facilement obtenu. Je râlais un peu parfois en faisant le décompte des jours passés, ces quatorze jours qui diminuaient si vite… Mais nous avions tellement de chance de pouvoir ainsi nous accaparer le monde. Pouvoir pointer au hasard une destination sur le planisphère et trouver le moyen de s’y rendre en trois clics sur internet. Nous dormions dans une chambre au confort incroyable pour seulement six euros la nuit, une somme misérable pour nous. Les restaurants nettoyaient les fruits et les légumes à l’eau minérale pour qu’on puisse s’offrir le luxe de manger une salade de tomate en plein coeur de l’Asie. Le soir, des groupes venaient animer les bars en reprenant des tubes de Police pendant que nous sirotions nos Get 27. Nous étions des enfants gâtés.
Le quatrième jour, Durdra est arrivé avec une bonne nouvelle : il avait enfin trouvé un chauffeur capable de nous conduire jusqu’au point de départ de notre randonnée. Il avait dû négocier, avait joint ses efforts avec un autre guide, aussi nous ferions le trajet en compagnie d’autres randonneurs. Le rendez-vous était pris pour le lendemain matin à l’aube. Nous étions prêts !
Quatre jours et quatre nuits. Inoubliables. La traversée de villages en pierres sèches éparpillés sans logique, comme si une main géante les avait lancés au hasard sur les pentes du massif. Nous avons longé des rizières, traversé des champs de Marijuana, croisé des ânes, des chevaux, des buffles, des chèvres, des poules, des chiens, des libellules… Lorsque nous peinions à venir à bout de montées trop raides, les enfants qui cavalaient tout sourire vers leur école ou les convois d’hommes portant sur leur dos d’immenses poteaux électriques pour les acheminer plus haut encore nous redonnaient la force nécessaire pour atteindre notre objectif. Nous alternions les heures brûlantes de la marche et les eaux glacées des douches des lodges qui nous accueillaient chaque soir, tous différents mais où nous nous retrouvions, fourbus, autour de l’inévitable Dahl Bat. Encore aujourd’hui ce plat de lentilles, légumes, et riz est synonyme de réconfort ; tout comme les Mars périmés vendus par des vieilles dames sur les sentiers me semblaient m’insuffler une énergie bouillonnante à chaque bouchée. Tous les matins, avant même le lever du soleil, lorsque nous retrouvions Durdra dans la salle à manger pour boire notre thé noir – nous avions vite renoncé à la mixture brune et épaisse qui tenait lieu de café, il s’activait à confectionner de petits sacs en tulle qu’il remplissait de sel. Il les fixait au bout de brindilles et lorsque nous traversions les épaisses forêts de conifère s’en servait d’arme redoutable pour décrocher les sangsues qui se glissaient partout sous nos vêtements. Il nous interdisait de boire l’eau des fontaines et veillait à ce que notre stock de bouteilles soit toujours suffisant. Parfois il se lançait dans de grandes conversations avec les villageois, se penchait ensuite sur la carte et nous expliquait qu’il faudrait changer d’itinéraire. La pluie qui gonflait la terre chaque nuit créait des coulées de boue qui nous obligeaient à faire de vastes détours, parfois à traverser des ponts de fortunes faits de planches posées à la va vite entre deux cordes.
Le dernier soir, alors que nous nous arrêtions près d’un lodge pour reprendre notre souffle après la traversée périlleuse d’une forêt, il nous demanda si nous souhaitions dormir ici ou continuer jusqu’au prochain, à trois heures de marche. Il était encore tôt, la descente nous amusait, nous avons choisi de poursuivre. Nous nous sommes donc remis en route. Au bout d’une demi-heure l’averse s’est mise à tomber, une pluie froide et pénétrante qui semblait ne jamais vouloir s’arrêter. Le dernier kilomètre, des marches de pierre avaient été creusées sur le sentier. L’eau les rendait glissantes et, alors que nous devinions les lueurs du prochain village en contrebas, fourbus et affamés, nous étions forcés de ralentir le pas. Dès que nos jambes accéléraient le rythme, nous dérapions dans nos lourdes de chaussures de randonnée et nous retrouvions les fesses sur le sol gelé. Nous avons fini le trajet en nous agrippant à Durdra. Ce dernier lodge était le moins accueillant de tous. Un grand cube de béton sans charme. Nous étions trempés et grelottant. En me déshabillant, j’ai compté quinze sangsues réparties sur mes jambes. Le filet d’eau qui coulait de la douche était glacial. Durdra nous a remonté des bassines d’eau chaude et des stocks de couverture, et m’a offert les quelques petits sachets de sel qui lui restait. Lorsque, un peu réchauffé, nous sommes descendus manger notre Dahl dans la salle à manger austère, nous avons insisté pour qu’il dîne avec nous et non avec les autres guides, comme il en avait l’habitude. J’ai sorti la petite flasque d’alcool de riz que j’avais cachée dans mon sac et nous avons trinqué. Il y avait à peine de quoi s’humecter les lèvres mais c’était bon, brûlant. Le repas fût joyeux, l’alcool balayait la tristesse qui commençait à nous étreindre.
Au retour à Pokhara, nous aurions aimé nous attarder un peu, mais nous arrivions au bout des quatorze jours légaux. Nous n’avions plus assez de temps pour repasser par Katmandou, aussi Durdra nous a recommandé de trouver un bus vers la frontière la plus proche, à Sunouli. Il a insisté pour que nous prenions un car touristique – j’avais entre temps appris que les routes du Népal étaient parmi les plus accidentogènes au monde, et la vétusté des véhicules n’y étaient pas pour rien. Deux jours de suite nous nous sommes rendus à l’arrêt de bus, deux jours de suite nos tentatives se sont avérées infructueuses. Les attaques continuaient sur les petites routes, et les chauffeurs refusaient de partir. Nous avons dû nous rabattre sur un bus local. Une vieille carcasse toute déglinguée aux freins crissant et sans une once d’amortisseurs. A chaque nid de poule, nous faisions des bons sur nos sièges. Durant les sept heures qu’il nous a fallu pour parcourir moins de deux-cents kilomètres, les Népalais tombaient malades les uns après les autres. Heureusement nous nous étions gavés de cachets anti mal de mer. Sur la fin du parcours, une route étroite et sinueuse surplombant une rivière, le chauffeur devait régulièrement faire des écarts pour éviter les tas de pierre éboulés sur le goudron, frôlant dangereusement la rambarde qui nous séparait du précipice, rambarde elle-même détruite par endroit. Mes ongles griffaient le tissu élimé de mon siège. Mais nous avons fini par arriver sain et sauf, et avons marché jusqu’au poste frontière. Sur les conseils de Durdra, nous avions glissé un billet dans nos passeports. Aussi le passage s’est fait sans encombre. Nous nous sommes engagés sur la route, au milieu d’une foule colorée, dans la lumière orange et floue, ce mélange de brume et de soleil. Nous étions revenus en Inde.
*****
J’ai regroupé les documents avec soin et je les ai remis dans leur pochette. Il y a des trésors : le permis de trek, le billet d’entrée à Durbar square, le plan de Katmandou, la note d’un salon de massage à Pokhara, la carte de visite d’un des lodges de l’Annapurna, une recette de Dahl Bat griffonnée en anglais.
Quand j’y repense, nous étions tellement insouciants, inconscients presque. La dangerosité des routes, la menace des failles qui courent dans les profondeurs de la terre, l’instabilité politique… tout ça glissait sur nous sans nous atteindre. Nous avalions notre voyage à grandes goulées.
Avant de refermer la boîte, j’ai jeté un œil à l’album photo que j’avais édité en deux exemplaires : un pour Christophe, un pour moi. Dedans, des photos de paysages époustouflants, des silhouettes croisées furtivement dans les villes ou sur la montagne, des sacs remplis d’épices et les fils tendus sur lesquels flottaient des dizaines et des dizaines de petits drapeaux colorés. On en voyait partout là-bas, c’est étrange que ma mémoire les ait à ce point exclus des images qui me sont revenues en me rejouant le film de ce voyage. Je n’ai aucune photo de Durdra, même parmi celles que j’ai retrouvées en allant exhumer le blog que je tenais à l’époque. J’ignore pourquoi. Peut-être tout simplement parce que nous pensions le revoir. J’étais convaincue de vite revenir au Népal, je voulais y emmener mon fils, lui faire découvrir ce pays découvert presque malgré moi et qui m’avait tant éblouie. J’aimerais avoir des nouvelles de Durdra, savoir s’il va bien, le tremblement de terre a fait tant de morts. Mais son numéro s’est perdu au gré des changements de téléphone successifs.
Aucune photo. Alors qu’au fond ce qui nous reste de plus précieux, ce qu’on ne peut pas revivre simplement en surfant sur le web ou en regardant des documentaires, ce sont bien les rencontres. Je l’ai compris plus tard, ce qui compte, ce sont les gens. Un ami partant pour faire la route avec vous, deux suissesses rigolotes et généreuses, un guide de montagne au sourire éclatant qui rêvait à son tour de parcourir le monde, traverser les frontières.
Parmi tout ce fouillis de papiers que j’avais conservé, il y avait un petit carnet. Je ne l’ai pas remis dans la boîte. Sur les feuilles quadrillées Durdra avait écrit les termes anglais que nous ne connaissions pas et qui revenaient sans cesse pendant notre excursion : “Leech”, (Sangsue) ; “custard”, ou plutôt “no custard”, sésame essentiel pour éviter cette crème anglaise écœurante reconstituée à base de poudre dont les cuisiniers des lodges arrosait la sempiternelle “apple pie” qu’ils nous servaient en dessert ; suspension bridge ; sunburn, headache… et tout au bout de la liste, comme un présage : “Landslide”. Glissement de terrain.







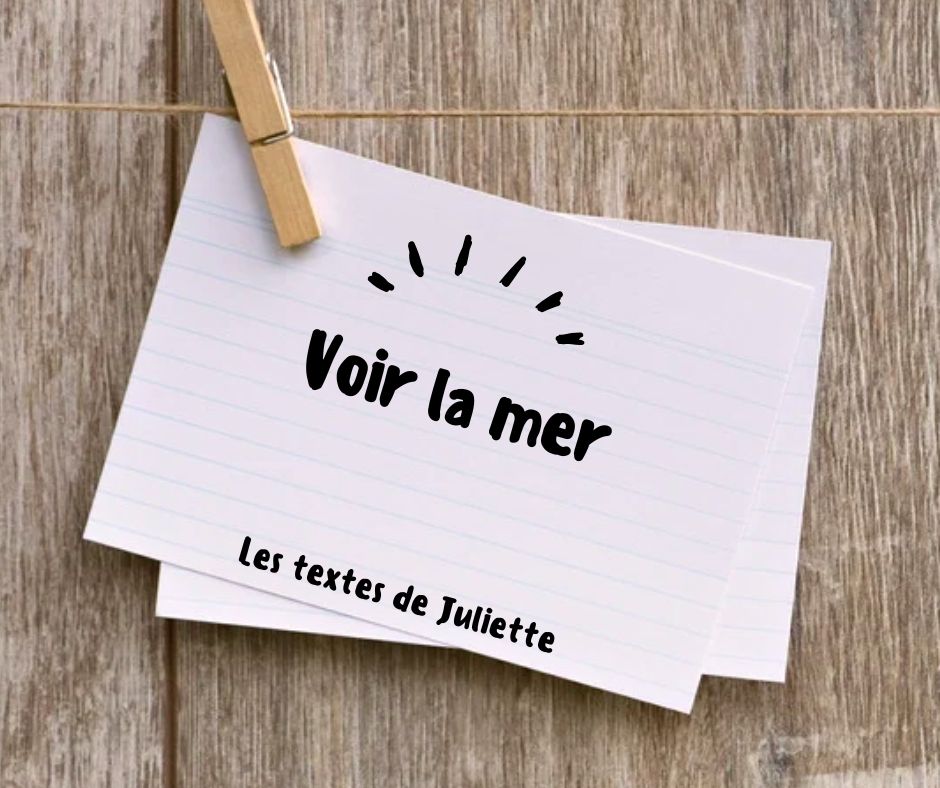

Laisser un commentaire